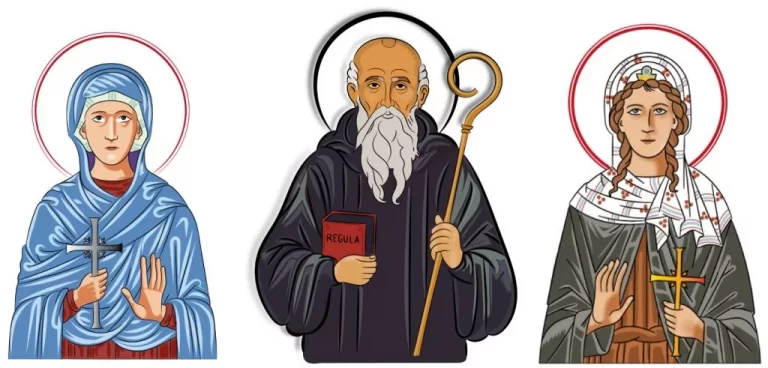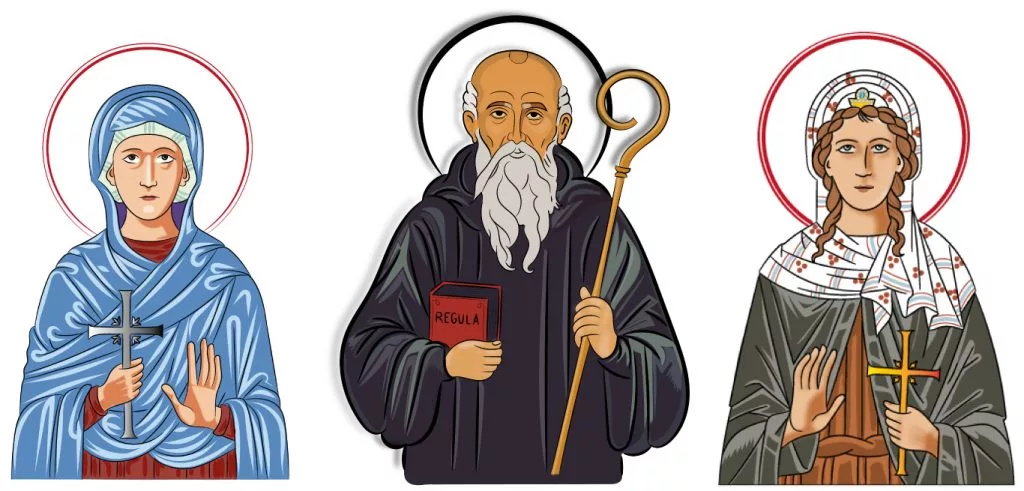1°) L’Hexaméron, ou livre sur l’ouvrage des six jours. C’est un supplément aux homélies de saint Basile sur le même sujet. Ce dernier avait omis toutes les questions qui étaient au-dessus de la portée du peuple. Saint Grégoire entreprit de les expliquer, à la prière de plusieurs personnes recommandables par leur science et leur vertu, et il le fit avec une exactitude digne d’un frère du grand Basile. Il montre dans cet ouvrage qu’il avait une parfaite connaissance de la philosophie ancienne.
2°) Le Traité de la formation de l’homme peut être regardé comme une continuation de l’ouvrage précédent, quoiqu’il ait été composé le premier, c’est-à-dire vers l’an 379. Il est très curieux et plein d’érudition : on y trouve de fort belles choses sur l’excellence et sur la dignité de l’homme, sur sa ressemblance avec Dieu, sur la spiritualité de son âme, sur la résurrection des corps, etc.
3°) Le livre de la vie de Moïse ou de la vie parfaite, est adressé à un certain Césaire, qui avait prié le Saint de lui apprendre en quoi consiste la vie parfaite, afin qu’il tâchât d’y parvenir. Saint Grégoire lui traça un modèle accompli de toutes les vertus dans la personne de Moïse.
4°) Les deux Traités sur l’inscription des Psaumes, et l’Homélie sur le Psaume sixième. Saint Grégoire donne dans ces deux traités une idée générale des psaumes, dont il fait voir la merveilleuse utilité pour la sanctification des fidèles. Il dit que de son temps les chrétiens de tout âge, de tout sexe, de toute condition, avaient sans cesse dans la bouche ces divins cantiques.
5°) Les huit Homélies sur les trots premiers chapitres de l’Ecclésiaste. Elles renferment des instructions admirables sur les vertus et les vices, et sur les effets qui en sont les suites.
6°) Les quinze Homélies sur le Cantique des cantiques, qui furent toutes prêchées, sont adressées à une vertueuse dame de Constantinople, nommée Olympiade, qui, devenue veuve après environ vingt trois mois de mariage, distribua ses biens aux pauvres et aux églises. Le saint docteur y dit que le livre du Cantique des cantiques ne doit être lu que par ceux qui ont le cœur pur et dégagé de l’amour des créatures.
7°) Les cinq Homélies sur l’Oraison dominicale, qui furent aussi prêchées, contiennent des instructions fort utiles sur la nécessité et sur l’efficacité de la prière.
8°) Les huit Homélies sur les huit béatitudes sont du même style que les précédentes. On y trouve des instructions solides sur l’humilité, la douceur, la pauvreté d’esprit, etc.
9°) Les Traités sur la soumission du fils, et sur la Pythonisse, et le Discours sur l’ordination de saint Grégoire. Il n’est pas certain que le premier ouvrage soit de notre saint docteur. L’erreur des Origénistes sur la cessation des peines des damnés parait y être enseignée. Ceux qui attribuent ce traité à saint Grégoire disent que l’erreur qu’on y trouve, y a été ajoutée après coup par quelque Origéniste. Le traité sur la Pythonisse est en forme de lettre, et adressé à un évêque nommé Théodose. Saint Grégoire y agile la question de l’évocation de l’âme de Samuel, et pense que ce fut le démon qui, sous la figure de Samuel, parla à Saül. Le discours sur l’ordination, qu’on devrait plutôt appeler le discours sur la dédicace, fut prononcé en 394, à l’occasion de la dédicace d’une magnifique église que Ruffin, préfet du prétoire, avait fait bâtir au bourg du Chêne, près de Chalcédoine.
10°) L’Antirrhétique, ou traité contre Apollinaire. Il n’y en avait qu’un fragment dans les éditions des œuvres de saint Grégoire ; mais Laurent Zacagnius, bibliothécaire du Vatican, le donna en entier en 1698, d’après un manuscrit de plus de sept cents ans. Léonce de Byzance, Euthymius et saint Jean Damascène en citent plusieurs endroits sous le nom de saint Grégoire, et le sixième concile général le lui attribue. On ne peut donc douter que ce Père n’en soit l’auteur. Il fut composé vers l’an 371. Le saint docteur y prouve, contre Apollinaire, que la divinité est impassible, que Jésus-Christ a une âme, qu’il réunit en sa personr1e la nature divine et la nature humaine, etc.
11°) Le Discours sur l’Amour de la pauvreté, qui est une exhortation pathétique à l’aumône. Le Livre contre le destin : où il est prouvé que tout arrive par l’Ordre de la Providence. Il fut composé vers l’an 381, et est écrit en forme de dialogue, Le Traité des notions communes, qui est une exposition philosophique des termes dont les anciens s’étaient servis pour expliquer le mystère de la Trinité.
12°) L’Epitre canonique à Létoïus, évêque de Mélitine, métropole d’Arménie. Elle fait partie des canons pénitentiaux publiés par Bévéridge. Saint Grégoire y prescrit des pénitences pour les péchés les plus énormes. D. Ceillier a montré, t. VIII, p. 265 et 266, le peu de solidité des raisons qui ont déterminé quelques protestants à rayer cette épitre du catalogue des ouvrages de saint Grégoire de Nysse.
13°) Discours contre ceux qui diffèrent leur baptême. Les pécheurs y sont exhortés à la pénitence, et les catéchumènes à recevoir le baptême par des raisons très-fortes qui se tirent principalement de l’incertitude de l’heure de la mort, et des divers accidents qui peuvent à chaque instant nous précipiter dans le tombeau.
14°) Les Discours contre la fornication et l’usure, sur la pénitence et l’aumône, offrent une très-belle exposition de la morale chrétienne sur ces divers points. Le Discours contre l’usure mérite une attention particulière, par la manière forte et intéressante dont les choses y sout traitées.
15°) Discours sur la Pentecôte. Témoignage contre les Juifs. On n’avait qu’en latin le premier ouvrage ; mais Zacagnius l’a publié en grec d’après trois manuscrits de la bibliothèque du Vatican. Saint Grégoire se propose, dans le second ouvrage, de prouver le mystère de la Trinité contre les Juifs par les propres paroles de l’Ecriture. On ne l’avait non plus qu’en latin, avant que Zacagnius en eût publié le texte grec. Ce savant n’ayant pas trouvé dans les manuscrits les trois derniers chapitres des anciennes éditions latines, en a conclu, avec raison, qu’ils étaient supposés, et au lien de ces trois chapitres, il en a donné quatre autres qui font une suite et rendent l’ouvrage complet.
16°) Les douze livres contre Eunomius. Saint Grégoire y venge la mémoire de saint Basile, son frère, attaqué par Eunomius, et y prouve, contre cet hérésiarque, la divinité et la consubstantialité du Verbe. Il y dit qu’indépendamment de l’Ecriture sainte, qu’il emploie avec une sagacité merveilleuse, la tradition seule suffirait pour confondre les hérétiques.
17°) Le Traité à Ablarius, et le Traité sur la foi. C’est une défense de divers points de la doctrine catholique contre les Ariens.
18°) La Grande Catéchèse, divisée en quarante chapitres, est citée par Théodoret, Léonce de Byzance, Euthymius, saint Germain de Constantinople : les vingt dernières lignes y ont été ajoutées après coup. Dans cet ouvrage, saint Grégoire de Nysse apprend aux catéchistes comment ils doivent prouver, par le raisonnement, le mystère de la foi.
19°) Le Livre de la virginité est divisé en vingt-quatre chapitres, non compris le prologue. Le saint docteur y montre l’excellence de la virginité, et les avantages qu’elle a sur l’état du mariage.
20°) Les dix Syllogismes, contre les Manichéens, et le Livre de l’âme et de la résurrection. Il est prouvé, dans le premier ouvrage, que le mal n’est point une nature incorruptible et incréée, non plus que le diable, qui en est le père et l’auteur. Le second est un dialogue ou récit d’un entretien que saint Grégoire eut avec sa sœur la veille de sa mort, sur celle de saint Basile. Il fut composé vers l’an 380.
21°) La Lettre à Théophile, patriarche d’Alexandrie, contre les Apollinaristes. Elle est citée dans le cinquième concile général et dans la Panoplie d’Euthymius.
22°) Trois Traités de la perfection chrétienne. Saint Grégoire examine dans le premier à quoi obligent le nom et la profession de chrétien ; il trace, dans le second, des règles pour arriver à la perfection ; dans le troisième, intitulé le But du chrétien, il développe et met dans tout leur jour les maximes les plus saintes de l’Evangile.
23°) Le Discours contre ceux qui ne veulent point être repris, et le Traité des enfants qui meurent prématurément. Plusieurs questions intéressantes sont traitées dans le second ouvrage.
24°) Le Discours sur la Nativité de Jésus-Christ, et les deux Panégyriques de saint Etienne. D. Ceillier prouve, t. VIII, p. 345, qu’on ne peut contester le discours à saint Grégoire. Il y est parlé, non-seulement de la naissance de Jésus-Christ, mais encore du meurtre des innocents. On ne trouvait que le premier panégyrique dans les anciennes éditions ; on est redevable à Zacagnius de la publication du second.
25°) Discours sur le baptême, la résurrection et l’ascension de Jésus-Christ. Le premier, qui est intitulé dans quelques éditions, sur le jour des lumières, fut prononcé à la fête de l’Epiphanie, jour auquel on baptisait les catéchumènes dans les églises de Cappadoce. Des cinq discours sur la résurrection, il n’y a que le premier, le troisième et le quatrième qui paraissent être de saint Grégoire.
26°) Discours sur la divinité du Fils et du Saint-Esprit. On y trouve la réfutation des erreurs des Ariens et des Eunoméens.
27°) Les Panégyriques de saint Basile et des quarante Martyrs, les Oraisons funèbres de Pulchérie et de Placille ; les Vies de saint Grégoire Thaumaturge, de saint Théodore, de saint Mélèce, de saint Ephrem et de sainte Macrine.
28°) Le Discours sur la mort a été fort maltraité par les hérétiques. Le but de saint Grégoire était de fournir des motifs de consolation aux chrétiens qui s’affligeaient excessivement de la mort de leurs proches.
29°) Plusieurs lettres. Dans celle qui est intitulée : Sur le Pèlerinage de Jérusalem, le saint s’élève contre plusieurs abus que commettaient quelques chrétiens sous prétexte de visiter les lieux saints ; mais il ne condamne point les pèlerinages en eux-mêmes, comme l’ont prétendu plusieurs protestants. Outre les lettres dont nous venons de parler, Zacagnius en a donné quatorze autres, d’après un manuscrit du Vatican. Jean-Baptiste Carraccioli, professeur de philosophie au collège de Pise, en fit aussi imprimer sept, qui n’avaient jamais été publiées, à Florence, 1731, in-folio. Il les avait tirées d’un manuscrit de la bibliothèque du grand-duc de Toscane.
Saint Grégoire de Nysse peut être comparé aux plus célèbres orateurs de l’antiquité, pour la pureté, l’aisance, la douceur, la force, la fécondité et la magnificence de son style ; mais il se surpasse en quelque sorte lui-même dans ses ouvrages polémiques. Il y montre une pénétration d’esprit singulière, et une sagacité merveilleuse a démasquer et à confondre les sophismes de l’erreur. C’est celui de tous les Pères qui a le mieux réfuté Eunomius. On a seulement reproché à saint Grégoire d’avoir trop donné à l’allégorie, et d’avoir quelquefois expliqué, dans un sens figuré, des textes de l’Ecriture, qu’il aurait été plus naturel de prendre à la lettre.
La meilleure édition des œuvres de saint Grégoire de Nysse est celle que Fronton le Duc donna en grec et en latin à Paris, en 1615, 2 v. in-folio ; mais il faut y joindre le troisième volume aussi in-folio, que le même Fronton le Duc donna en 1618 par forme d’appendice. On préfère cette édition avec le supplément, à celle qui parut à Paris, en 1638, 3 vol. in-folio.
On trouvera une édition très-correcte, grecque-latine, dans la Patrologie de M. Migne.